De l’oral et l’écrit, l’histoire millénaire des examens
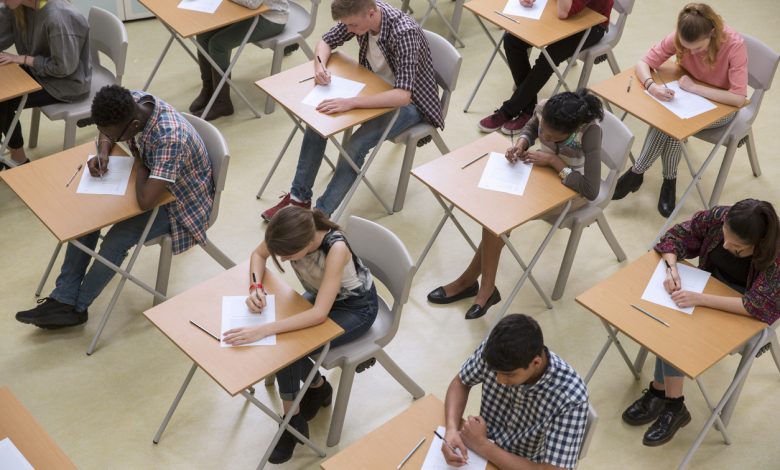
De l’oral et de l’écrit, l’histoire millénaire des examens!
Nadine Sayegh-Paris

Lorsque l’on parle d’examens, on pense immédiatement à une salle de classe, des copies à remplir et un jury prêt à interroger. Pourtant, cette institution, aujourd’hui banale, plonge ses racines dans des traditions millénaires qui ont façonné les civilisations, de la Chine impériale au Moyen-Orient médiéval, en passant par l’Europe moderne.
En Chine ancienne, dès la dynastie Sui (VIe siècle) puis surtout sous les Tang et Song, on trouve les fameux examens impériaux (科举, keju) pour recruter les fonctionnaires. Ces concours comportaient des épreuves écrites très strictes (composition littéraire, poésie, commentaires de textes classiques). Ainsi que des oraux notamment pour évaluer l’éloquence et la culture générale. Ce modèle, d’une rigueur exceptionnelle, a profondément marqué les voisins de la Chine, comme la Corée et le Vietnam.
Dans l’Antiquité grecque et romaine, l’épreuve par excellence était l’oral. Les écoles de rhétorique formaient les citoyens à l’art du discours : déclamer, argumenter, persuader. La réussite se mesurait à la force de la parole plus qu’à la plume.
Dans l’Europe médiévale du XIIe et XIIIe siècles, à Paris, Bologne, ou Oxford, les premiers examens universitaires étaient quasi exclusivement oraux. On passait une ‘disputatio’ devant un jury, en soutenant sa thèse ou en répondant à des objections. Les examens écrits ne se sont imposés que plus tard, à partir du XVIe siècle, avec la diffusion de l’imprimerie et de la scolarisation massive.
Au Moyen-Orient, l’éducation islamique a également valorisé l’oralité, en particulier dans la mémorisation et la récitation du Coran. Les madrasas, institutions d’enseignement apparues au XIe siècle, évaluaient la capacité des étudiants à restituer les textes et à discuter de leur interprétation juridique (fiqh). La transmission reposait donc beaucoup sur la parole et la mémoire, mais des certificats écrits, aussi, appelés ijazat, sanctionnaient la fin d’un apprentissage et donnaient le droit d’enseigner à son tour.
Quant à l’Empire ottoman, le système des concours administratifs s’inspirait à la fois de la tradition islamique et des modèles orientaux. Si l’oral restait très présent, notamment pour juger de la maîtrise des textes religieux et juridiques, l’écrit commençait à jouer un rôle croissant dans les examens de recrutement et la correspondance officielle.
Avec l’invention de l’imprimerie, au XVe siècle, et la diffusion des écoles, l’écrit s’impose peu à peu en Europe. Le grand tournant a lieu au XIXe siècle. En France, Napoléon crée en 1808 le baccalauréat, combinant épreuves orales et écrites. Ce modèle s’étend rapidement aux autres pays européens et colonisés, imposant l’écrit comme norme de l’évaluation scolaire et universitaire.
De nos jours, les examens combinent héritage de l’oral et domination de l’écrit. Mais derrière chaque copie rendue ou chaque jury affronté, c’est toute une histoire millénaire qui continue de s’écrire, reliant les salles closes des concours impériaux chinois, la parole des maîtres grecs, les ijazat des madrasas et les amphithéâtres modernes. Un vrai témoin de l’évolution de l’éducation et de la société, à travers les siècles !





